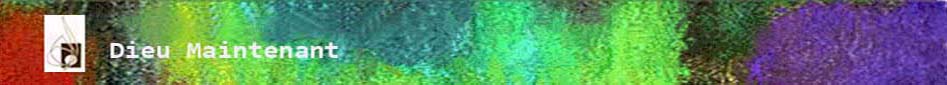

Le mariage des chrétiens de l’Église latine à travers les siècles
Michel Poirier
3- De la Réforme au XVIe siècle jusqu’à la Révolution française
4- De la Révolution française jusqu’au concile Vatican II
La Révolution française, puis le Code civil aboutissent à une situation généralisée où le mariage n’est réglé que par la loi civile, le sacrement de mariage n’apparaissant plus que comme un supplément facultatif. Enfin le concile Vatican II, sans s’attaquer explicitement aux normes héritées du passé, développe une réflexion sur le mariage et sur le couple qui remet au centre la communion des personnes.
La Révolution française et le Code civil
En toile de fond, la Constitution civile du clergé (juillet 1790) et le schisme qui s’ensuivit, entre l’Église constitutionnelle et les réfractaires fidèles à l’autorité romaine. On se bornera à ce qui concerne le mariage. Jusque-là, en France, un état civil laïque n’avait été institué qu’au bénéfice des protestants, celui des catholiques continuait d’être géré par les paroisses. Après bien des débats sans conclusion à la Constituante, l’Assemblée législative vota le 20 septembre 1792, juste avant sa dissolution, une loi qui instituait le mariage civil pour tous, contracté devant un officier public et non le curé. En même temps était prévue la possibilité du divorce, la liste des empêchements était revue, les empêchements d’ordre religieux (disparité de culte, prêtrise, vœux, parenté spirituelle) disparaissaient. Le mariage religieux et sacramentel n’était plus qu’un supplément éventuel. Sauf pour le divorce, dont la possibilité fut supprimée de 1816 à 1884, nous n’avons pas cessé jusqu’à aujourd’hui de vivre pour l’essentiel sous ce régime, malgré de nombreux aménagements et modifications au fil des ans et des évolutions politiques (1). Parallèlement pendant toute la période révolutionnaire des mesures furent votées visant à favoriser les familles fécondes.
Un cas très particulier, pour lequel il y a une réponse romaine du 28 mai 1793, ne manque pas d’intérêt. En Vendée, où les catholiques sont très fidèles au pape, et où les curés non jureurs se cachent ou ont fui et sont peu joignables, il n’est pas question de se marier devant un prêtre constitutionnel tenu pour schismatique, ce serait nul, et on ne serait pas marié non plus par un mariage purement civil devant les autorités. Que faire ? demande à Rome l’évêque de Luçon. Pie VI fait répondre que dans l’impossibilité de trouver un prêtre légitime, on pourra contracter mariage par l’échange des consentements devant témoins, sans la présence du curé, et que ce mariage sera valide et licite. Les fidèles ainsi mariés pourront ensuite déclarer leur union devant l’officier civil, pour assurer la publicité de leur mariage et pour que soient acquises toutes ses conséquences sociales et juridiques, à condition qu’ils aient bien conscience que, contrairement à ce que peuvent prétendre les autorités, cette déclaration n’est pas leur mariage ; le Code de droit canonique de 1917 entérinera cette possibilité « extraordinaire ». Pour nous, l’intérêt de mentionner cette instruction, c’est qu’au passage elle écarte nettement la thèse selon laquelle le prêtre serait ministre de ce sacrement comme de tous les autres, thèse à laquelle certains théologiens étaient encore attachés. Les ministres sont bien les conjoints.
Au long de 19e siècle, et même au-delà, la papauté ne cessa de ferrailler contre la laïcisation du mariage, d’autant plus qu’après qu’elle eut été entérinée dans le Code civil élaboré sous le Consulat, ce code influença de nombreux codes en d’autres pays, d’abord chez les vassaux de l’Empire napoléonien, puis malgré la déroute impériale progressivement à travers l’Europe et le monde. Notons que tout en intégrant l’essentiel des transformations révolutionnaires, le Code civil revint sur le caractère un peu anarchique de certains innovations, Bonaparte voulait restaurer l’autorité. Tout en la tempérant un peu, le code établit l’autorité du mari sur l’épouse et la famille, il nous faudra attendre la période la plus contemporaine pour que la loi reconnaisse une égalité totale entre les conjoints. Le divorce fut désormais bien plus encadré et limité qu’il ne l’avait été au temps du Directoire, et la Restauration l’abolit. Il ne fut rétabli en 1884 qu’après qu’un grand nombre de pays, il est vrai surtout de culture protestante, l’eurent institué.
De son côté la papauté ne cessa de rappeler que selon elle le mariage est indissoluble, qu’en lui contrat et sacrement sont absolument liés, et qu’en conséquence seule l’Église est compétente pour en fixer les conditions, l’État devant se borner à assurer les conséquences civiles de l‘union. Le Code de droit canonique promulgué en 1917 mit pour la première fois dans un texte unique des positions jusque-là dispersées dans des décrets et instructions publiés en fonction des débats du moment. Même le Concile de Trente avait laissé de côté certains points. La laïcisation du mariage n’en continua pas moins de progresser dans de nombreux pays.
Raidissement romain et aspiration à une vraie spiritualité conjugale
Arrivés à ce moment de cette histoire, si nous nous retournons pour mesurer le chemin parcouru, il apparaît que les interventions de l’autorité ecclésiastique ont été la plupart du temps de nature juridique, ont porté souvent sur les conditions de validité de la conclusion de l’union. Il s’agit de bien organiser le rapport de deux personnes, d’un homme et d’une femme, mais en vue de quoi ? La fin principale de leur association est constamment placée dans le don de la vie à des enfants et leur éducation, afin non seulement de perpétuer l’humanité mais aussi (d’abord ?) d’offrir des fidèles à l’Église et à Dieu. La famille est au centre des préoccupations, non le couple en tant que tel. L’aide mutuelle que se portent les époux est aussi prise en considération, mais en second lieu. À l’occasion, on promeut l’amitié entre les époux (qui n’allait pas de soi dans le cas d’unions négociées par les familles), mais l’union charnelle elle-même n’est envisagée que sous l’angle de la procréation, et secondairement comme remède à la concupiscence (des hommes). Les chemins de sanctification offerts à chacun concernent chacun, non le couple. Notons pourtant ce point positif capital : il n'a jamais été perdu de vue que le sacrement repose sur l’échange de deux consentements libres, même si dans la société réelle des pressions s’exercent.
Pendant des siècles et des siècles la forte mortalité infantile et l’existence de terres non encore défrichées ont fait que le problème d’une éventuelle limitation des naissances n’a pas été posé publiquement, même si dans le secret des alcôves bien des épouses épuisées par les grossesses à répétition auraient eu des raisons de le mettre en avant. Et l’Église a préféré longtemps demander aux seuls confesseurs d’éclairer individuellement les consciences, en prônant le respect des processus naturels et en appelant à la maîtrise et à l’abstinence. Mais le problème va émerger dans la société, et les théories de Thomas Malthus (1766-1834), qui prêche pour une restriction des naissances en avançant des raisons économiques, en sont le signe. Depuis ce moment, à chaque fois que la question sera posée à Rome à l’occasion de réflexions de tel ou tel moraliste, de tel ou tel théologien, la même attitude négative sera affirmée. Même le recours à une activité sexuelle limitée aux périodes de chaque mois où la femme ne peut être féconde, méthode d’ailleurs bien aléatoire, sera parfois critiquée parce qu’on y utilise un rythme certes naturel en vue du seul plaisir, en écartant volontairement ce qui est la fin naturelle, voulue par Dieu dès l’origine, de ce genre d’acte. On loue bien sûr une affection mutuelle des époux, un amour profond, mais on répugne à considérer positivement l’union charnelle sous cet angle, à la tenir pour intrinsèque à cet amour indépendamment de sa finalité familiale.
C’est là une attitude qui aura de plus en plus de mal à passer au 20e siècle, à mesure que les laïcs seront de plus en plus appelés par la hiérarchie elle-même à former des équipes pour prendre en chrétiens des responsabilités dans leur milieu de vie. On connait surtout l’Action Catholique spécialisée (ouvrière, agricole, étudiante, des milieux indépendants), mais le même état d’esprit va pousser des couples à se réunir pour réfléchir et progresser ensemble dans l’aventure de leur vie de foyers, y compris sous l’angle de la valorisation spirituelle de ce type d’existence, dans toutes ses dimensions. Mentionnons les Équipes Notre-Dame, la revue L’Anneau d’Or, et beaucoup de groupes informels. On y recherche une véritable spiritualité conjugale, prenant en compte toute la vie à deux, du plus charnel au plus spirituel.
Le concile Vatican II
Les projets préparés par la Curie ne faisaient que répéter les positions habituelles. Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, les évêques adoptèrent une perspective profondément différente, dans les paragraphes de la Constitution Gaudium et Spes qui traitent du mariage (n° 47 à 52). Dès le premier paragraphe il est question de « communauté conjugale », de « communauté d’amour ». Cette communauté est établie sur « l’alliance des conjoints » : le mot alliance, qui fait référence à l’alliance de Dieu et de son peuple, se substitue discrètement au mot contrat, purement juridique. L’amour qui unit les deux personnes du couple « peut enrichir d’une dignité particulière les expressions du corps et de la vie psychique et les valoriser comme les éléments et les signes spécifiques de l’amitié conjugale ». Ce qui relève du corps dans la vie conjugale n’est plus considéré comme simplement nécessaire pour la fécondité, mais participe pleinement à l’expression et au progrès de la communauté humaine et spirituelle qu’instaure le mariage, ce n’est pas étranger à la grâce du mariage. Une telle communauté de vie et d’amour, selon le concile, est naturellement ouverte sur l’accueil d’enfants, mais le paragraphe qui en traite ne vient qu’ensuite, et il considère les enfants comme un don à accueillir plutôt que comme une fin à réaliser, et si la naissance d’enfants se révèle impossible le mariage, en tant que communauté et communion de toute la vie garde toute sa valeur.
Les époux chrétiens n’ont, me semble-t-il, pas eu l’impression que le concile eût changé grand-chose dans leur condition, d’autant plus que le pape Paul VI avait cru bon de se réserver la question du contrôle des naissances, ce qui fait que les évêques n’avancèrent que quelques mots vagues sur la responsabilité des époux, et l’on sait que l’encyclique Humanae Vitae fut une totale fermeture. Même statu quo sur les divorcés remariés. Cependant, dans les pages de Gaudium et Spes sur le mariage l’accent s’est déplacé, on est passé d’une approche essentiellement juridique à une réflexion sur la nature profonde interpersonnelle de l’union, cette communauté plénière. Cela n’a pas encore produit grand-chose au niveau des décisions romaines, mais au moins le nouveau Code de droit canonique (1983) entérine que le mariage est une alliance (plutôt qu’un contrat), « une alliance par laquelle un homme et une femme constituent une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants ». Ce déplacement d’accent mérite qu’on s’en saisisse, que les couples vivent leur aventure dans cette perspective.
Pour conclure
Au début de cette histoire, nous avons rencontré le beau texte d’Éphésiens 5, qui présente l’union de l’homme et de la femme comme un « mystère » greffé sur l’union du Christ et de l’Église, et par là sur l’Incarnation de Dieu en notre monde. Je ne doute pas que de nombreux époux chrétiens aient pu trouver le moyen de vivre de ce mystère, mais c’est resté dans le secret des couples, et il n’en a guère été question dans notre parcours historique. Très vite on s’y heurte à un certain pessimisme augustinien sur la partie corporelle de l’amour humain, pessimisme que d’ailleurs favorisent les réticences néoplatoniciennes et stoïciennes de la philosophie commune de ce temps-là.
Puis, à mesure que la civilisation médiévale s’organise, on voit se développer à propos du mariage des normes juridiques qui tentent d’être de plus en plus précises, même quand la réalité des mœurs renâcle à s’y plier, en même temps que l’autorité ecclésiastique se réserve progressivement le monopole de la fixation de ces normes dans une société de chrétienté où la religion donne forme à toute la vie sociale. Ces normes ont mis constamment en avant la procréation et l’éducation des enfants comme fin n° 1 du mariage, la communauté de vie et l’aide mutuelle comme fin seconde, l’indissolubilité, la fidélité, et comme fondement de la conclusion de l’union l’échange libre des consentements.
Mais à partir du 16e siècle ce monopole va être de plus en plus contesté, d’abord là où le protestantisme l’emporte, puis dans des monarchies catholiques devenues des monarchies absolues, avant que la Révolution française, puis le Code civil et sa large diffusion n’aboutissent à une situation généralisée où le mariage de l’ensemble des citoyens n’est réglé que par la loi civile (2), le sacrement de mariage avec ses normes propres n’apparaissant plus dans notre société que comme un supplément facultatif. Enfin le concile Vatican II, sans s’attaquer explicitement aux normes héritées du passé, a développé une réflexion sur le mariage et sur le couple qui remet au centre la communion des personnes et la communauté sans réserve de la vie dans ce qu’elle a de plus charnel jusqu’au plus spirituel. Ce changement de perspective est loin d’avoir encore produit tous ses effets.
Michel Poirier
1- Rappelons que la loi française interdit actuellement aux ministres du culte la célébration de tout mariage religieux qui n’aurait pas été précédé par la cérémonie civile. / Retour au texte
2- Dans quelques pays, comme l’Italie, un concordat a cependant stipulé que les catholiques pouvaient se dispenser de la cérémonie civile, et que l’enregistrement de la cérémonie religieuse entraînerait tous les effets civils du mariage. Des accords de même type ont été conclus avec d’autres religions. Dispositions analogues en Espagne. / Retour au texte



