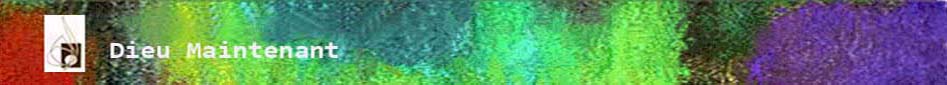

Un été aux champs
Julien Lecomte
Le monde agricole a exprimé sa colère avec une rare intensité en ce début d’année 2024. Pour négocier la sortie de crise, le gouvernement a pris des mesures inquiétantes pour la biodiversité, qui ne résoudront pas la dégradation structurelle des conditions économiques de la profession. L’article aborde la question agricole en relatant une expérience personnelle de l’auteur, qui lui a révélé la complexité et la diversité de cette activité, et dont la conversion écologique reste un enjeu crucial.
Une crise d’ampleur
En ce début d’année 2024, les agriculteurs français, mais aussi allemands, ont exprimé leur colère d’une manière rarement atteinte. Un drame a frappé les manifestations françaises, par la mort accidentelle d’une agricultrice sur un barrage routier. Fait inédit, deux représentations syndicales, pourtant réputées opposées, ont convergé dans la contestation : la FNSEA et la Confédération paysanne. La première est dirigée par Arnaud Rousseau, un grand patron de l’agrobusiness, ce qui ne signifie pas non plus que tous ses syndiqués lui soient comparables, loin s’en faut. La seconde défend une agriculture dite paysanne, autonome, rejetant le productivisme et soucieuse de travailler avec la nature pour répondre aux besoins de la société. Mais quel que soit le syndicat auxquels ils adhèrent, tous les agriculteurs ont exprimé d’une seule voix cette revendication : pouvoir vivre dignement de leur travail.
Le vieux manteau du productivisme
Les dernières mesures prises par le gouvernement pour tenter d’améliorer le sort des agriculteurs inquiètent tous les défenseurs de l’environnement, car elles s’appuient sur un gel des plans de réduction des intrants chimiques (pesticides, phytosanitaires). L’Union Européenne est prête à emboiter le pas. La biodiversité, mais aussi la santé humaine, est la grande perdante de ces négociations de sortie de crise. C’est, de plus, le fruit d’une vision court-termiste qui ne résoudra pas les problèmes structurels de notre agriculture, soumise à des normes plus strictes que celles de ses voisins européens et internationaux, mais pourtant mise en concurrence déloyale avec leurs productions aux prix plus bas, mais aussi à la qualité plus basse. Ainsi l’exige le dogme néolibéral du libre marché qui prévaut en Europe.
Depuis des années, l’agriculture peut faire penser au vieux manteau de la parabole, qu’on tente de rapiécer, mais qui finit quand même par tomber en lambeaux (Matthieu 9,16). Les gouvernements successifs cousent des mesures, à caractère environnemental pour plusieurs certes, sur la vieille étoffe du productivisme. Les résultats escomptés ne se produisent pas : la grande majorité des agriculteurs n’arrive que très difficilement à vivre de son travail, leur nombre continue de diminuer et, sujet tabou, les suicides touchent dramatiquement la profession. Et on ajoutera que la biodiversité continue de s’effondrer dans les régions d’agriculture intensive.
Le manteau neuf, tout comme les outres neuves pour le vin nouveau, c’est le changement systémique de nos modes de production et de consommation alimentaires. Il est facile à décréter sur le papier mais bien plus difficile à mettre en œuvre du champ à la fourchette. Si l’on insiste, à juste titre, sur les barrières des lobbys, n’oublions pas nos propres résistances à modifier nos habitudes alimentaires (1).
Depuis cette crise, nombre de spécialistes et d’experts se succèdent dans les médias pour fournir analyses et clés d’explication. Mais plutôt que de proposer ici une paraphrase de ces débats, je souhaiterais témoigner d’une expérience personnelle au contact direct du milieu agricole, il y a déjà plus de deux décennies. Bien qu’elle fut brève, son souvenir m’est resté vif et les observations que j’ai pu en retirer me semblent encore d’actualité. A vous d’en juger.
Une expérience au contact du monde agricole
Il y a vingt-cinq ans désormais, j’ai exercé, durant un mois d’été, la fonction de contrôleur PAC pour l’Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) de Lille. J’étais chargé d’aller vérifier in situ la conformité des dossiers déposés par les exploitants agricoles pour pouvoir bénéficier des primes afférentes à la Politique Agricole Commune, la bien connue PAC européenne. Concrètement, c’était un job d’été, confié à des jeunes gens, qui nécessitait seulement une base de connaissances simples, complétées par une formation de quelques jours à l’ONIC. Les dossiers étaient tirés au sort, et ils nous étaient distribués selon notre zone géographique de résidence.
Ce contrat me fit d’abord parcourir des secteurs ruraux du département nordiste, dont je n’étais pas originaire. Surtout, je découvris de l’intérieur les réalités socio-économiques du milieu agricole. La situation de mon lieu de résidence d’alors, à Valenciennes, fit se répartir mes contrôles sur deux zones agricoles contrastées : à l’est, l’Avesnois, une terre vallonée de pâtures et de bocages dédiée à l’élevage laitier (zone AOC du fromage de Maroilles), et à l’ouest, les vastes plateaux limono-argileux du Cambrésis, partie septentrionale du Bassin parisien, dévolus aux grandes cultures intensives. Deux mondes complètement différents.Une forte disparité sociale
Les agriculteurs sont loin de former un tout homogène, bien au contraire. Au sein même de cette catégorie professionnelle, désormais réduite à moins de 2% de la population active, les disparités sociales et économiques y sont aussi fortes que dans l’ensemble de la société. L’agriculture a ses très riches et ses très pauvres.
Je contrôlais des petites fermes laitières comme de grosses exploitations céréalières. En pénétrant dans la cour d’une ferme, son statut économique se percevait immédiatement. Chez les humbles « herbagers » de l’Avesnois, bien que jeune et débarquant avec ma vieille bagnole crachotante, j’étais accueilli avec déférence, presque comme une personnalité. Chez les cultivateurs du Cambrésis, le détachement était plus perceptible. Et je ne rencontrais pas forcément le propriétaire. Certains d’entre eux s’étaient diversifiés dans des activités nécessitant un important investissement. Ainsi, je me souviens d’un exploitant qui était également transporteur routier, disposant d’une petite flotte de semi-remorques conduits par ses chauffeurs salariés, les vastes bâtiments de la ferme servant de garages pour les poids lourds. Un autre boursicotait sur les cours des matières agricoles, peu attentif à mes explications lorsqu’il m’accueillit, finissant son petit déjeuner sans rien me proposer. Ce fut une journée harassante car il fit le strict minimum pour m’aider dans ma tâche.
La dimension familiale, plus ou moins intégrée, était également une composante différenciatrice entre les éleveurs laitiers et les cultivateurs. Chez les premiers, on avait davantage tendance à travailler en famille que les seconds. Dans une ferme laitière au cœur de l’Avesnois, le mari, la femme et les enfants adultes travaillant sur l’exploitation, étaient tous présents pour le contrôle. J’ai le souvenir de gens avenants qui me proposèrent une boisson à mon arrivée et, leur demandant un verre de lait de la ferme, me répondirent, désolés, que le camion de la collecte était déjà passé. Ils ne gardaient que rarement un litre pour leur consommation personnelle et il leur arrivait même d’en acheter au supermarché.
Une agriculture soucieuse de l’environnement et une autre qui s’en fout
Je n’ai pas contrôlé d’exploitations en agriculture biologique, mais les normes imposées aux producteurs laitiers du bocage les incitaient de facto à davantage de préoccupations environnementales. Les maigres primes qu’ils touchaient sur les pâtures étaient conditionnées au maintien des haies – j’y reviendrai. Le cahier des charges de production du lait de l’AOC fromage de Maroilles impose la mise au pré des vaches durant une période minimale sur l’année. L’herbe naturelle et la haie, favorables à la biodiversité, étaient leurs outils de travail, et le sont plus encore aujourd’hui : ils se doivent d’en prendre soin. Ils cultivent toutefois quelques hectares de maïs fourrager destiné à l’ensilage pour la nourriture hivernale.
Alors que je contrôlais un champ de maïs dans le Cambrésis, je demandais à l’agriculteur s’il était vrai que cette culture laissait, après récolte, une terre largement purifiée des plantes adventices, un ouï-dire que j’avais entendu. Sa réponse décomplexée me stupéfia : « Je n’en sais rien, mais avec toute l’Atrazine qu’on y balance, il n’y a plus rien qui pousse derrière ! ». L’Atrazine est un herbicide interdit depuis 2003 dans toute l’Union européenne suite à sa toxicité prouvée sur l’environnement et la santé humaine. Elle continue d’être utilisée dans le monde, en particulier aux USA.La PAC, un système productiviste
Je ne crois pas que le modèle de fond de la PAC ait réellement évolué depuis cette année-là. Il est fondamentalement basé sur la quantité, c’est-à-dire la capitalisation des surfaces, puisque les primes sont calculées à l’hectare : plus vous disposez de surfaces, plus vous percevez d’aides. Cette approche quantitative découle d’une conception productiviste : les montants des primes favorisent l’agriculture intensive céréalière et oléo-protéagineuse. Du moins était-ce le cas de la PAC en cet été d’il y a vingt-cinq ans.
J’ai gardé en mémoire les montants des primes à l’hectare, encore en francs à l’époque :
- 500 francs pour l’herbe,
- 2000 francs pour le maïs fourrager,
- 3000 à 4000 francs pour les céréales et oléo-protéagineux,
- 5000 francs pour le lin, une culture très primée mais aussi très surveillée, car les contrôleurs devaient obligatoirement être accompagnés d’un agent fonctionnaire de l’ONIC pour tout dossier le concernant.
Il y avait également l’obligation de maintenir des jachères, techniquement appelées « gel », pour pouvoir bénéficier des primes. Paradoxe du productivisme…
Concernant la prime sur les pâtures, elle était conditionnée à la contractualisation de Mesures Agri-Environnementales (MAE). Concrètement, pour la percevoir, les éleveurs laitiers étaient tenus de conserver les haies bocagères cernant leurs prés, et plus encore de les entretenir à leurs frais. Autrement dit, la production la plus dure, celle de l’élevage laitier, et la seule articulée à une vraie contrainte de qualité environnementale, était six fois moins aidée que la grande culture intensive céréalière.
Un herbager n’avait pas non plus intérêt à faire la course à la surface, puisqu’à l’époque, la production laitière était encore limitée par les quotas. Du moins pour concentrer des hectares de pâtures, car les quotas laitiers ont eu aussi pour effet la mise en labour des prés, des terres lourdes et humides qu’il faut drainer, en dégradant les qualités paysagères et écologiques du bocage. La mise en place des MAE était une tentative de freiner ce mouvement.
La disparition des paysans
Lors d’un de mes contrôles, je fus accueilli par un vieux paysan, au visage buriné par des décennies de labeur, et qui aurait dû prendre sa retraite depuis plusieurs années. Je garde un souvenir touchant de sa calme résignation : aucun de ses enfants n’avait voulu reprendre la ferme. Alors elle allait disparaître sous peu, car déjà revendue à un autre exploitant. C’était son dernier été.
J’avais en face de moi l’illustration vivante de la lente disparition des paysans, que le modèle productiviste de la PAC provoque en poussant à la concentration des exploitations pour garantir leur survie économique.L’armée mexicaine ?
L’armée révolutionnaire mexicaine eut jadis la réputation de posséder plus de généraux que de soldats. L’expression est restée pour désigner l’hyperbureaucratisation d’une organisation au détriment de ses agents productifs. L’agriculture lui est comparable. Vue de l’extérieure, elle semble l’affaire des agriculteurs, sauf que son encadrement technico-administratif est conséquent.
A l’époque, j’avais pu dénombrer les organismes suivants dédiés totalement ou partiellement à l’activité agricole :
- Les services départementaux de l’État, soit la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, fusionnée depuis 2010 dans la Direction Départementale des Territoires et de la Mer - DDTM),
- La chambre d’agriculture, subdivisée en chambre régionale et départementale,
- La MSA, la « sécu » du monde agricole (Mutualité Sociale Agricole),
- L’ADASEA, association de développement et de support à l’agriculture,
- Mon employeur l’ONIC et son jumeau l’ONIOL (OL pour oléagineux), créations du Front Populaire pour réguler les prix agricoles et donc alimentaires,
- Le Parc naturel régional de l’Avesnois (PNR), qui avait obtenu de monter les dossiers de MAE pour les agriculteurs de son territoire.
La liste n’est probablement pas exhaustive. En effet, quelques années plus tard, j’eus l’occasion de collaborer avec des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER), titulaires d’un droit de préemption sur le foncier agricole. A cela faudrait-il sans doute rajouter les collectivités départementales et régionales qui intègrent des compétences liées à l’agriculture. Et peut-être existe-t-il d’autres entités que j’ignore encore, sans compter celles de l’Union Européenne.
Je serais curieux de connaître le ratio entre le nombre de producteurs agricoles sur le terrain et le nombre de personnels dans tous ces organes, pour les comparer aux indices équivalents dans les autres secteurs d’activité publics et privés. Par ailleurs, l’on retrouve beaucoup de fils et filles d’agriculteurs parmi ces agents tertiaires. A défaut de prendre la succession des parents, on devient bureaucrate de l’agriculture.
La dimension stratégique de l’agriculture justifie peut-être ce déploiement administratif. Ma perception d’une armée mexicaine serait alors à nuancer. Cependant, je reste interrogatif sur l’importance d’un tel encadrement quand les agriculteurs s’inquiètent du risque de leur propre disparition.
Le paysan écolo ou l’agriculteur pollueur ?
« Pas de pays sans paysans ! », scande depuis bien des années un slogan des organisations syndicales agricoles. Pour ma part, je ne l’interprète pas dans une optique néo-agrariste, mais comme une alerte, celle de l’importance vitale pour tout pays de maintenir sa production alimentaire nationale. Et c’est bien une lutte inégale qui se joue à l’échelle mondiale entre le paysan et l’agriculteur, celle de la production alimentaire familiale, locale et durable face au big agrobusiness écrasant les systèmes vernaculaires, imposant ses productions globalisées, ses intrants chimiques et prédatant les terres. Ce dernier phénomène ne concerne pas que les pays du Sud car il se produit également en France, de manière silencieuse mais inquiétante (2).
Les deux syndicats agricoles nationaux que sont la FNSEA et la Confédération Paysanne, aux conceptions divergentes, reprennent cette dichotomie dans leurs propres dénominations. La première signifie Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, tandis que la seconde revendique l’agriculture paysanne par son nom.
Cette dichotomie traverse la société au sein de laquelle la vision du métier oscille entre celle du gros exploitant cupide et pollueur, d’un côté, et celle du petit paysan héroïque, de l’autre. Or mon expérience estivale, certes brève mais marquante, m’a ouvert à une réalité bien plus complexe que ce manichéisme. Cependant, il est absolument inacceptable que la majorité de celles et ceux qui produisent notre alimentation crève de faim. Ce n’est pas en sacrifiant la biodiversité que le problème sera résolu mais bien par un changement systémique d’ampleur, porté par une volonté politique affirmée. Cependant, une étudiante en école d’agronomie m’avait rappelé que le monde agricole est largement conservateur, tenant du « on a toujours fait comme ça ». Le changement passera aussi par une confrontation avec ces conservatismes, et, sur ce sujet, la formation des prochaines générations d’agricultrices et d’agriculteurs a un rôle décisif à jouer.
Julien Lecomte, Avril 2024
Peintures de Pierre Meneval

1- Voire notre article ici-même sur le sujet : manger1.html / Retour au texte
2- Voir également sur le sujet crucial des terres agricoles à l’échelle mondiale notre article : manger1.html / Retour au texte
