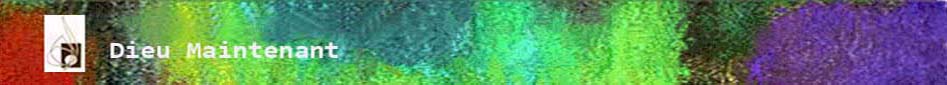

De la périphérie aux périphéries
Julien Lecomte
La crise sociale actuelle des « Gilets Jaunes » fait émerger analyses, débats et controverses autour de la notion de « périphérie ». Ainsi, les dits Gilets Jaunes proviendraient d’une France périphérique, fragilisée par la mondialisation libérale, s’opposant à celle du centre, insérée dans ce même processus économique. Mais où se situe cette France périphérique ? Des géographes, des urbanistes et d’autres spécialistes s’écharpent pour déterminer les espaces qui la composeraient.
Et si nous sortions du déterminisme spatial de la périphérie ? C'est ce que tentent d’abord ces lignes, qui proposent une ressource pour penser la périphérie autour de la conception du pape François d’une « Église des périphéries ».
Julien Lecomte est professionnel de l’aménagement du territoire. Il exerçe depuis une quinzaine d’années en indépendant. Il est aussi un lecteur assidu et un ami très proche de « Dieu maintenant ».
Le vieux modèle français centre-périphérie
L'image un brin folklorique de la France a longtemps été celle d'un pays très lisiblement séparé en deux espaces géographiques : la ville et la campagne. Avec leurs avantages et leurs inconvénients respectifs, comme dans la fable de La Fontaine Le rat de ville et le rat des champs (livre I, fable IX).
Bien que la France actuelle soit urbanisée à presque 80%, la réminiscence d'une campagne où la vie serait plus frugale mais plus authentique reste tenace chez nos concitoyen(ne)s. Le centre urbain et sa périphérie rurale ont ainsi longtemps offert un modèle simple à notre géographie nationale, probablement parce que la France, premier pays agricole d’Europe, a été industrialisée et urbanisée plus tardivement que d’autres de ses voisins. Mais avec l’évolution urbaine de la France, à partir des années 70, ce modèle binaire s’est fissuré. Un troisième espace est apparu : ni rural, ni urbain, et de surcroît changeant selon le point de vue. Certains l’ont nommé « périurbain », terme qui n’a jamais produit de consensus scientifique. Un géographe – controversé – comme Christophe Guilluy identifie ce milieu périurbain à la périphérie qui manifeste actuellement sa colère : la France modeste des zones pavillonnaires et commerciales édifiées sur les terres agricoles, en grande couronne des métropoles régionales. Il est intéressant de remarquer que le point d'achoppement des débats ne porte visiblement pas sur la définition du centre mais bien plus sur celui de la périphérie. Alors comment envisager la périphérie ? Comment la définir ?
Ce que nous proposons ici n'est pas d'apporter une énième définition mais de faire un pas de côté : et si la périphérie n'était pas qu'une notion ontologiquement spatiale ?De l'autre côté de l'Atlantique, une autre vision de la périphérie
La chanteuse, actrice et productrice américaine Jennifer Lopez, dite J-Lo, pop star mondiale née en 1969, a grandi dans le quartier du Bronx à New-York, fille d'un couple d'immigrés porto-ricains de la petite classe moyenne. De cette origine modeste, elle a tiré le "single" de son troisième album qui consacra sa carrière internationale : Jenny from the block. Dans le refrain de cette chanson, elle s'adresse à celles et ceux qui la regardent jalousement :
Don't be fooled by the rocks that I got / I'm still, I'm still Jenny from the block / Used to have a little, now I have a lot / No matter where I go, I know where I came from (from the Bronx !) - (copyright Epic Records 2002)
Ce qui peut se traduire de cette façon :
Ne sois pas berné (ou dégoûté) par les pierres que je porte / Je suis toujours, toujours, Jenny du bloc / J'avais presque rien, maintenant j'ai beaucoup / Peu importe où je vais, je sais d'où je viens (du Bronx !).
Sous l’apparente frivolité d’un tube pop, nous avons ici la description du système urbain des grandes villes américaines, qui offrent un modèle tout à fait différent de notre dichotomie spatiale française. La grande ville américaine est dessinée en quadrillage régulier, créant une succession de blocs. Et d’un bloc à l’autre, le contraste social peut être considérable. Le Bronx queJennifer Lopez revendique avec fierté est celui des années 70-80. À cette époque, ce quartier était l’image même du cauchemar urbain, particulièrement sa partie sud : Harlem. Le photographe Camilo José Vergara en a réalisé des clichés saisissants. Mais faut-il aussi rappeler que Harlem jouxte l'épicentre de New-York, l'orgueilleuse Manhattan, et ne constitue donc pas un quartier éloigné, relégué aux confins de la métropole ? La misère de l'époque côtoyant ainsi la richesse, toutes deux spatialement concomitantes, ou pour le dire plus nettement : le centre et la périphérie de l'échelle sociale américaine occupant le même et étroit espace géographique qu'est cette pointe de la presqu'île formée par l'embouchure du fleuve Hudson.
Qui serait une Jenny du bloc à la française alors ? Une "fille des banlieues" assurément, ayant grandi loin du centre, dans une périphérie spatialement éloignée de celui-ci. Or Jenny from the block nous permet de jeter un autre regard sur la notion de périphérie s’exprimant ici par le contraste violent de la différence sociale, sur le même espace géographique. D'un côté le bloc misérable, pourri par la drogue et la violence, sorte de paria périphérique, et de l'autre côté de l'avenue, le bloc aisé, riche et intégré au centre de la société américaine. On passe ainsi d'une vision horizontale à une vision verticale de la dichotomie centre-périphérie.Verticalité de la périphérie
Restons encore un peu à New-York pour évoquer une des explorations les plus saisissantes de la verticalité qu'est le travail de la photographe Diane Arbus. Née dans une famille bourgeoise new-yorkaise en 1923, elle a bouleversé l'art photographique de son époque. Sa première série marquante, publiée en 1960 dans le magazine Esquire, s'intitule justement The Vertical Journey ("Le voyage vertical"). Cette série explore la ville de New-York au travers des personnes pauvres, vivant aux marges, déclarées anormales ou brouillant les représentations conventionnelles. Tout son travail a gravité autour des travestis, des marginaux, de l'étrange et du bizarre, de la confusion des genres, des "freaks", souvent photographiés à vif en portraits de rue. En face de ce monde troublant, Diane Arbus met en regard la bonne société des années 60 de la ville. La verticalité devient alors vertigineuse : c'est celle de l'abîme. À l'époque de sa publication, la démarche est révolutionnaire.
Il ne faudrait pas considérer la verticalité de Diane Arbus comme un moment historique. Elle existe toujours ; et tout autant. Le SDF - puisque depuis longtemps la peur des mots a banni celui de "clochard" - survivant sur le trottoir au pied d'un bel immeuble parisien en est l'un des exemples les plus fréquents. Le SDF, un être humain placé à la périphérie de l'humanité et qui fait se détourner les regards, ne vit que quelques mètres en bas du propriétaire d'un cossu appartement parisien, dont on connaît le prix. Quelle image plus forte et tristement banale de la verticalité absolue de la périphérie ?
Pour témoigner d'une expérience personnelle, il n'est pas compliqué de pratiquer le voyage vertical à la Diane Arbus, ici en France. Dans tout milieu, urbain ou rural, nous restons toujours saisis par le profond fossé de l’inégalité sociale. Elle est même souvent plus visible, à nue, dans certains milieux ruraux, où un taudis peut voisiner un domaine opulent. Vingt années de pratique professionnelle en témoignent.
Notre conception française de la périphérie se fait de manière principalement spatiale, appuyée sur le modèle d'horizontalité de l'occupation des sols, renforcé par sa représentation planimétrique. Depuis un centre, qui peut même contenir un hyper-centre, il élabore des successions de couronnes concentriques, naguère nommées faubourgs puis banlieues. Les digitations de l'urbanisation dans les villages de la "campagne" environnante sont devenues difficiles à caractériser. Le terme de périurbain est un néologisme qui tente de décrire cet objet qui n'est plus vraiment l'urbain et plus vraiment le rural, à l'inverse de la séparation claire de jadis.
Envisager la périphérie de manière complémentaire sous l'angle de la verticalité permet de sortir du carcan conceptuel que nous impose ce spatialisme, et des impasses où nous mènent certaines des questions qui en découlent. La verticalité nous montre que, sur la même portion d'espace, peuvent se côtoyer le centre et la périphérie : dichotomie non plus seulement déterminée spatialement mais aussi sociale, économique, juridique, morale, culturelle et spirituelle. Cette approche par la verticalité permettrait de contrebalancer les décorticages analytiques un peu vains et contradictoires voulant absolument identifier l'espace-type constituant la périphérie. Qu'on ne se méprenne pas sur mon propos : la question de l'espace reste fondamentale mais ne doit pas occulter les autres, qui se posent en d'autres termes que ceux de l'horizontalité. Toutes les revendications sociales et politiques que l'on a vu émerger pendant la crise des "Gilets Jaunes" veulent aussi interpeller "ceux d'en haut", selon l'expression courante. Bottom-up plutôt que top-down, comme disent les anglophones.
Petite mystique des périphéries
Pour clore ces quelques réflexions, je vais faire appel à une pensée des périphéries que je juge très stimulante : celle du pape François. L'évêque de Rome est issu d'une famille modeste d'immigrés, des italiens installés en Argentine, les Bergoglio. Il a grandi dans des quartiers populaires, ceux de Buenos-Aires. Une histoire qui peut évoquer d’ailleurs celle de notre pop star américaine Jennifer Lopez. C'est un pape de la périphérie, le premier de la longue histoire de l'église catholique à être extra-européen. Son mode de vie comme sa façon de s'exprimer sont périphériques. Refusant les appartements pontificaux, il vit au sein d'un modeste logement de cinquante mètres carrés, dans l'austère résidence Sainte-Marthe, tandis que bien des prélats-nababs du Vatican occupent de vastes et luxueux appartements, entourés de marbre et d'or, bien loin de la simplicité évangélique. Sa manière de s'exprimer est restée celle d'un prêtre qui s'adresse aux foules populaires d'Argentine. Comme l'a relevé le journaliste Patrice de Plunkett, fin connaisseur du pape François, Jorge Bergoglio parle à la façon d'un porteño, terme qui désigne l'enfant d'immigrés composant une large partie des habitants de Buenos-Aires ou de Montevideo. Mais cette manière périphérique de parler, qui tranche avec l'habituelle rhétorique européenne, ne va pas sans créer parfois des malentendus.
En novembre 2013, quelques mois après son élection pontificale, François a publié l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium ("La Joie de l'Évangile"). François y expose sa pensée, et même plus encore y développe une mystique des périphéries. Car il emploie toujours le terme au pluriel. Les périphéries sont celles de l'exclusion, de la détresse sociale et économique, des banlieues et des campagnes pauvres, mais désignent aussi les périphéries spirituelles, comme celles du vide existentiel qu'engendre, par exemple, l'ultra-consumérisme devenu pour beaucoup le seul horizon humain. Comme souvent avec François, la vision est donc intégrale. Nous pourrions dire qu'elle envisage la périphérie simultanément dans ses deux dimensions : verticale et horizontale, d'où la pluralité des périphéries.
Il est singulier de lire, sous la plume du dirigeant suprême de l'église catholique, cet appel à "sortir", à littéralement "périphériser" l'Église, cette très vieille institution réputée hiérarchisée jusqu'à la sclérose, étouffante et étouffée dans son hyper-centralisation :
Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. (...) Plus que la peur de se tromper j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection (...). (Evangelii Gaudium, 49 - p. 42 et 43).
Si du point de vue de l'administration ecclésiale, François plaide pour une vraie décentralisation de l'institution, y compris celle du rôle pontifical, il témoigne aussi et d'abord d'une spiritualité du décentrement. Celui-ci est l'action même que produit l'Esprit sur l'Homme dans l'Évangile de Jean : "Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va" (Jean 3,8 - trad. AELF). Le vent de l'Esprit est imprévisible : il ne provient pas d'une source identifiée, fixe, c'est-à-dire d'une centralité. Rebelle, il ne se laisse pas enfermer. Tout au contraire, il arrive d'on ne sait où pour se diriger vers on ne sait quoi : il est radicalement périphérique. Il n'est donc pas exagéré de parler ici d'une mystique des périphéries chez François.
Les périphéries vers lesquelles le pape François voudrait mettre en mouvement l'Église sont porteuses d'un double sens. Le réalisme oblige à en envisager tous les aspects négatifs : relégation, violences, difficultés de tous ordres. C’est un rude terrain de lutte pour les Chrétiens qui s’y engagent. Mais l'espérance de l'action les envisage aussi comme des lieux de décentrement, porteurs de régénération autant institutionnelle que spirituelle.
Dans une perspective laïque, il semble que ce potentiel des périphéries soit souvent oublié. Les périphéries peuvent aussi ouvrir un dialogue fécond avec le centre... pour peu que ce dernier fasse l'effort de l'écoute et du refus de l'auto-enfermement. Il ne faudrait pas confondre systématiquement les marges avec la marginalité, et encore moins les marges avec la marginalisation.
Cette rencontre des périphéries par le centre doit s’accompagner d’une indispensable réciprocité pour que le second échappe au dualisme mortifère paternalisme / mépris. L’action du père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart-Monde, est un exemple édifiant : la réciprocité était placée au cœur de sa conception de l’aide aux plus démunis.
Julien Lecomte (copyright - janvier 2019)
Peinture de Pierre Meneval


